Sélection de productions scientifiques associées au projet ANFRICHE:
- Veitch, A. (2023). « Reconquête de friches » et assemblages résistants de la terre. A contrario, 34, 81-107. https://doi.org/10.3917/aco.222.0081
Résumé :
Cet article propose d’étudier la mise en œuvre d’une résistance locale de propriétaires fonciers qui est parvenue à faire suspendre un projet de transformation territoriale porteuse d’espoirs multiples. En Bretagne, une région très fortement marquée par un modèle agricole industriel qui subit de vives critiques, l’équipe municipale d’une commune littorale a lancé un projet de « reconquête » de plusieurs centaines de terres agricoles dites « friches ». Les effets espérés étaient divers : relocalisation alimentaire, production biologique pour la restauration collective, création d’emplois, retour d’un paysage bocager. Alors que le projet, largement acclamé, se met en route, il se heurte à une mobilisation inattendue : un groupe constitué de propriétaires des petits terrains agricoles enfrichés se mobilisent et bloquent l’action. Comment leur conception de la terre devient-elle un moteur de résistance ? L’enquête ethnographique auprès des habitant·e·s, propriétaires et pouvoirs publics, a fait émerger la concurrence de relations antagonistes à la terre, qui est assemblée alternativement comme ressource, héritage ou lieu de nature.
https://www.cairn.info/revue-a-contrario-2023-1-page-81.htm?contenu=article
- Guiet C. 2023, « Relocalisation de la production alimentaire et remises en culture contemporaines des « friches ». Le cas du littoral finistérien », Mémoire de Master 2 Environnement et Gestion du littoral, Université de Bretagne Occidentale/EHESS, 116 p.
Résumé:
Les tentatives de relocalisation alimentaire sur les espaces littoraux font face à des défis spécifiques. Sur le territoire de la communauté de communes Presqu’île de Crozon Aulne maritime, divers projets ont été initiés en faveur de la relocalisation, notamment le Plan Alimentaire de Territoire (PAT) porté par la collectivité. Ce mémoire examine comment ces projets se saisissent des enjeux fonciers sur un territoire soumis à de nombreuses contraintes urbanistiques, en explorant la question de la revalorisation des terres anciennement cultivées ou « friches agricoles ». L’intérêt pour les « friches agricoles », notamment pour des fins nourricières, implique de se poser la question de l’accès au foncier agricole, du potentiel agronomique des terres mais aussi de l’appropriation préalable de ces milieux par les habitant.e.s et agriculteur.rice.s du territoire. A travers une enquête ethnographique, il s’agit de caractériser le phénomène d’enfrichement, lié à l’histoire agricole du territoire, puis de décrire les interactions entre les espaces enfrichées et les politiques foncières pouvant être initiées dans le cadre des projets de relocalisation alimentaire. Enfin, il est question d’envisager les conditions dans lequel pourraient se réaliser des pratiques agricoles ou pastorales au sein de ces « friches », afin d’allier les enjeux de viabilité économique et préservation des dynamiques écologiques.
M2_EGEL_2022-23_GUIET_Charlotte_Rapport_compressed
- Libaud P. 2022, « La diversité paysagère des friches littorales. Etude écologique et paysagère de la végétation des friches littorales de Moëlan-sur-mer. » Mémoire de Master 2 GAED, Agrocampus Ouest/Université d’Angers/EHESS, 94p.
Voir un résumé ici ou télécharger le mémoire :
Sélection de productions scientifiques associées au projet Parchemins:
- Dupé S., Cardinal J., Levain A. 2021, « Vers une agriculture sans ruralité ? La renégociation de la place de l’agriculture sur l’île de Bréhat (XXè, XXIè siècle) » Norois, 259-260, Numéro spécial Habiter et protéger les îles, enjeux contemporains. URL : http://journals.openedition.org/norois/10922 ; DOI : https://doi.org/10.4000/norois.10922
Cet article analyse les effets de la littoralité sur l’évolution de l’inscription socio-spatiale de l’activité agricole, quand elle est exacerbée par le contexte insulaire, comme sur l’île de Bréhat. En croisant analyse spatiale et données ethnographiques, nous y repérons et décrivons, depuis le xxe siècle, des moments de déstabilisations successives construits à plusieurs échelles, qui redessinent la place et les fonctions de l’agriculture au cours du temps. Trois agencements socio-spatiaux temporairement stables, que nous
qualifierons de « pactes territoriaux », émergent. Les évolutions de l’inscription de l’agriculture dans l’espace social local sont corrélées à une transformation de la ruralité sur le territoire. Le premier pacte territorial s’étend du début du xxe siècle jusqu’aux années 1960. L’agriculture est vivrière et constitue un socle dans l’organisation sociale de l’île, bien que l’arrivée de touristes diversifie les ressources économiques locales. Au tournant des années 1960, l’ampleur du tourisme et la difficulté à s’inscrire dans les nouvelles politiques agricoles nationales déstabilisent cet équilibre. L’agriculture se marginalise et perd sa fonction localement structurante : la
fin des paysans coïncide avec la fin de la ruralité. Enfin, l’activité agricole se redynamise au cours de la dernière décennie, en même temps qu’elle est mise en débat publiquement, re-créant un espace de proximité entre divers usagers du territoire. C’est une forme de ruralité ré-inventée qui est consacrée, ouvrant une position circonscrite aux acteurs agricoles. Pour prétendre obtenir du foncier disponible, ils doivent s’insérer dans un modèle d’agriculture multifonctionnelle, faisant de l’île un jardin aux fonctions productives et esthétiques. Les rapports de force et la distribution du pouvoir préexistant évoluent peu, et l’agriculture locale reste marquée par des formes de précarité économique et foncière
- Squividant H., Revelin F. 2021, « S’hybrider sous le 4e paradigme de la “science dirigée par les données massives” : l’ouverture des données favorise-t-elle l’interdisciplinarité et la transdisciplinarité ? », Communication, technologies et développement [En ligne], 9 | 2021, mis en ligne le 23 mars 2021. URL : journals.openedition.org/ctd/3791
Nous avons encore peu de recul sur la manière dont les communautés productrices de matériaux de recherche se saisissent des enjeux de l’ouverture des données dans le contexte actuel du Big Data et de la Science Ouverte, dépeint par Jim Gray comme l’ère du nouveau paradigme de la “Science dirigée par les données massives” (Hey, 2009). En particulier, lorsque ces communautés rassemblent différentes cultures épistémiques, impliquant une pluralité de rapports à la donnée. En prenant appui sur l’expérience d’un programme de recherche portant sur les relations en agriculture et littoral en Bretagne (Parchemins, 2016-2020), nous décrivons comment une équipe de 10 chercheurs et ingénieurs issus d’horizons divers (agronomie, sciences et techniques de l’information, anthropologie et étude sociale des sciences) a intégré cet objectif en lien avec son ambition interdisciplinaire et transdisciplinaire, et a co-construit un système d’information modulaire et interopérable pour y répondre. Dans quelles mesures l’objectif de mise en partage des matériaux de recherche à un niveau à la fois interne et ouvert, favorise-t-il l’hybridation des approches scientifiques et l’ouverture de la science vers la société? La description fine de l’instrumentation technique et numérique du partage des matériaux de recherche nous permet de mettre en lumière et de discuter une partie de ces formes d’hybridation.
- Parnaudeau V., Pot M., Legrand M., Viaud V., Akkal-Corfini N., Godinot O., Roche B., Levain A. 2020. « Diversity, a way to maintain agriculture in an attractive coastal territory (France) ». 14th European Farming Systems Conference, Evora, 20-26 mars 2020.
Issues such as tensions between and coexistence of agriculture and other activities or land users have been studied in periurban and island areas. Agriculture has evolved to meet specific requirements of these areas: services such as providing food, especially local food, agrotourism services, ecological and environmental concerns and practices and “greener spaces”.
In the areas where agriculture is declining, strategies emerged to maintain or develop it, such as diversifying production systems or agricultural activities, which follow different development rationales and are driven first by the areas’ agricultural characteristics.
In this study, we hypothesize that specific pressures and dynamics of attractive coastal areas (touristic and residential) contribute to the development of specific agricultural features, such as internal and external diversity, ecology-oriented practices and a high degree of inclusion in local markets and social life. To test this hypothesis, we studied a small coastal area in Southern Brittany (the Rhuys peninsula, Western France) and drew a portrait of its agriculture using statistics and an agricultural survey. We also collected data using an ethnographic survey to understand agricultural changes from the perspective of local farmers and other local actors. We analysed farm practices, the farms themselves and the diversity of agriculture at the peninsula scale in response to driving forces of the area. We investigate the following questions: What are the key features of agriculture in this coastal area, and is diversity one of them? Can we observe a trend for the greening of agriculture? Does tourism drive certain local food supply chains or agrotourism opportunities? To what extent do tensions about land and coexistence of farmers and tourists or residents influence agriculture?
- Viaud V., Levain A., Legrand M., Squividant H., Parnaudeau V., Béra R., André A., Dupé S., Pot M., Cerf M., Revelin F., Toffolini Q. 2020. « Farming on the seaside: a framework to capture dominant patterns and features of coastal agriculture ». Journée d’étude Agriculture et littoralité: enquêter, décrire, partager, Rennes, 19 février 2020.
La présence et les formes de l’agriculture dans les espaces littoraux ont profondément évolué au cours du XXème siècle. A la différence d’autres agricultures d’interface, comme l’agriculture de montagne ou l’agriculture périurbaine, elle a rarement fait l’objet de travaux scientifiques spécifiques et n’est pas, aujourd’hui, pensée comme une catégorie descriptive ou d’analyse des systèmes de production. L’enjeu de cet article est de questionner la pertinence d’une telle catégorisation, à partir de données empiriques collectées dans le cadre du programme Parchemins, d’indicateurs contextuels mais également d’une analyse systémique questionnant les formes, la profondeur et la continuité de l’influence maritime sur les activités agricoles. En prenant appui sur la notion de configuration agro-littorale, il montre qu’il existe bien des traits spécifiques de l’agriculture littorale, qui ne peuvent se saisir qu’au travers de la compréhension intégrée et historicisée de ses interactions avec le littoral en tant que territoire, et pas seulement en tant que milieu.
- Revelin F., Squividant H., Beurier A.-G., Levain A. 2020. « Ce que l’intention de mise en partage des données fait aux pratiques des chercheurs en anthropologie« . Journée d’étude Agriculture et littoralité: enquêter, décrire, partager, Rennes, 19 février 2020.
La recherche publique est aujourd’hui traversée par des injonctions multiples à l’ouverture, qui se matérialisent à la fois par des obligations juridiques, des incitations des financeurs lors des appels et évaluations de projets de recherche, la mise à disposition par les tutelles d’infrastructures de publication de données et d’une offre spécifique de formation à destination des équipes de recherche.
Le travail de mutualisation et de publication des données qualitatives collectées dans le cadre du programme interdisciplinaire Parchemins peut être lu, dans ce contexte, comme une tentative pour apprivoiser et donner sens à ces injonctions, tentative portée par un idéal de co-construction des connaissances et de réduction des asymétries entre savoirs scientifiques et savoirs d’expérience. Cet article décrit comment l’équipe d’anthropologues du programme a composé, tout au long de ce processus, avec une série de tensions qui mettent à l’épreuve leur rapport aux données qu’ils produisent, aux personnes et situations qui en sont à l’origine, et à leur métier-même. A l’issue d’une expérience de trois années, il montre les déplacements de pratiques observés et propose une relecture des enjeux contemporains d’ouverture de la science à l’aune de l’éthique de la relation enquêteur-enquêté et du lien entre paradigmes scientifiques et instrumentation des disciplines.
- Revelin F., Squividant H., Raux P., Levain A. 2020. « Au-delà des injonctions: ce que la mutualisation des données nous apporte ». Séminaire Amure, Plouzané, 13 février 2020.
L’ouverture des données : on en parle, on en parle…mais que se passe-t-il quand on s’y met vraiment? Et comment peut-on s’y prendre lorsque les données en question sont des discours, des images, des archives, ou même des objets? A Amure, nous sommes nombreux à produire des données qualitatives et/ou hétérogènes, qui se laissent difficilement capturer dans des bases de données, mutualiser, réutiliser ou publier. Cette séance prendra appui sur l’expérience de publication d’un large corpus de données hétérogènes au sein d’un « catalogue » grand public, conduite dans le cadre du programme Paroles et chemins de l’agriculture littorale (INRA, 2016-2020), pour aborder le sens et les bénéfices de cette pratique, au delà des multiples injonctions qui sont adressées aux communautés de recherche pour qu’elles rendent leur données accessibles. Le but est d’aborder ce sujet concrètement, par les pratiques, et d’engager avec ceux qui le souhaitent un dialogue, voire une expérimentation de partage/publication des données issues des recherches menées à Amure.
- Levain A., Pattée S., Smadja F. 2019. « L’agriculture littorale, une agriculture de front? Spécificités et dynamiques socio-environnementales des activités agricoles en bord de mer« . Colloque Restobs, Crozon, 21 novembre 2019 : https://restobs.sciencesconf.org/data/pages/211119Pre_sentation_Restobs_Agriculture_littorale_CIVAM_Parchemins.pdf
- Revelin, F., Beurier, A.-G., Squividant, H., Levain, A. 2019. « Parchemins : espace d’expérimentation, espace d’enquête sur l’ouverture des données qualitatives ». Journée d’étude Données qualitatives : partager, archiver, ré-analyser. Où en est-on côté chercheur ?, Maison des Sciences de l’Homme de Bretagne, Rennes, 28 mai 2019
- Letessier D., 2019. L’écologisation de l’agriculture: quelles contributions des dynamiques littorales ? Mémoire de Master 2 Ethnologie et métiers du patrimoine. Université Paul Valéry, Montpellier III, 190 p.
Issu d’une enquête ethnographique menée au printemps 2019 sur le site d’étude de la Lieue de Grève, en baie de Lannon (Côtes d’Armor), ce travail s’intéresse à la parole des agriculteurs et agricultrices du territoire, afin de saisir leur expérience des transformations de leur activité sur ce territoire touché de longue date par des proliférations d’algues vertes, et sur lequel se pratique de façon très majoritaire un élevage laitier familial, à forte composante herbagère. L’analyse porte en particulier sur l’écologisation en cours de l’agriculture. Elle s’attache à décrire les relations entre le monde agricole et le littoral, et la façon dont les multiples représentations de cet espace créent une dynamique particulière à l’exercice de l’activité sur le territoire : à bien des égards, la Lieue de Grève peut être analysée comme un « front écologique », un espace de lutte et de négociation pour conserver à l’activité agricole sa légimité. Le processus d’écologisation de l’agriculture apparaît ainsi comme situé et ancré au coeur du front écologique littoral, donnant à penser l’évolution d’une activité fortement dépendante de la nature en tant que système biophysique, mais également en tant que représentation et espace de projection.
Mots-clés : Bretagne, Lieue de Grève, Baie de Lannion, agriculture, littoral, pollution diffuse, qualité de l’eau, écologisation, front écologique, ethnologie
- Cardinal J., Dupé S. 2019. « Reconfiguration du pacte territorial de l’île de Bréhat autour de l’agriculture », communication au colloque Iles2019, Brest, 17-18 novembre 2019.
Cette communication propose une analyse des dynamiques territoriales dans lesquelles s’insère l’agriculture à Bréhat depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Nous y décrivons les diverses phases que connait l’activité agricole depuis cette période, en nous attachant aux articulations de cette activité avec les autres secteurs économiques et sociaux de l’île. Nous voyons ainsi se succéder trois périodes : la première, antérieure à 1960, au cours de laquelle l’agriculture constitue essentiellement une ressource vivrière. La seconde s’étend des années 1960 à la fin des années 2000, au cours de laquelle cette activité est menacée par un développement économique essentiellement tourné vers le tourisme et la résidentialisation. Enfin, la dernière période s’amorce au début de la dernière décennie, au cours de laquelle le tourisme (au sens large) ne constitue plus seulement une menace pour le maintien de l’agriculture, mais devient une opportunité.
Dans une seconde partie, nous focalisons l’analyse sur les dynamiques contemporaines dans lesquelles s’inscrit l’agriculture. L’augmentation du nombre d’acteurs ayant une activité agricole, la multiplicité de leurs statuts et la diversité de leurs ancrages au territoire témoignent à la fois d’une forte dynamisation du secteur, mais également de sa précarité. Si le nombre d’agriculteurs augmente, les surfaces de foncier agricole restent stables. Cette densification est permise par divers mécanismes sociaux qui sont décrits : nouvelles stratégies de commercialisation des produits agricoles, réorganisation des rapports sociaux entre résidents secondaires et résidents principaux, arrivée de néo-ruraux porteurs d’idéaux favorables à la dynamisation de l’agriculture. Pourtant, bien que ces jeux d’alliance permettent de redonner une place aux agriculteurs et à l’agriculture sur l’île, ils ne rebattent pas complètement les cartes pour ce qui est des liens historiques qui existent entre agriculteurs, résidents permanents, résidents secondaires et touristes.
Mots-clefs : agriculture, littoral, insularité, tourisme, pacte territorial, patrimonialisation, écologisation
Le texte de la communication orale est disponible ici : Pacte territorial à Bréhat.
- Beurier, A.-G. 2019. « L’intermédiation à l’épreuve de la pratique — Analyse des activités de conception et d’intermédiation au sein du programme de recherche coopérative ‘Paroles et chemins de l’agriculture littorale’ (2016-2019) », Mémoire de Master 2 Gouvernance de la Transition, Ecologie et Société, AgroParisTech, 162 p.
Ce mémoire en sociologie de master 2 s’inscrit dans le domaine de la recherche sur les processus d’intermédiation. Il vise à enrichir la réflexion sur les effets du pluralisme épistémologique et de l’intention de démocratiser la recherche en contexte de transition sociotechnique. Pour ce faire, il s’appuie sur une étude ethnographique de six mois réalisée au sein du projet Parchemins – « Paroles et chemins de l’agriculture littorale » (2016-2020) -, programme de recherche coopérative qui regroupe une quinzaine de chercheurs et de chercheuses issu e s de 7 disciplines relevant des sciences de l’information, de l’environnement et des sciences sociales. Initié en 2016, ce projet poursuit un objectif de création de connaissances – documenter les spécificités de l’agriculture en zone littorale ainsi que ses transformations -, tout en visant à accompagner un changement : participer à faire exister l’agriculture littorale en tant que sujet et créer les conditions de son expression et de sa problématisation locale. Cette dernière intention est prise en charge par la mise en place d’activités de conception et d’intermédiation pendant le fonctionnement du programme.
Dans le cas des situations de transition sociotechnique, l’intermédiaire joue un rôle de support dans la construction et l’identification d’un problème, la fixation des objectifs et l’établissement des solutions. Les activités d’intermédiation permettent alors d’articuler les connaissances produites par les chercheurs (objectivation) avec les représentations et les systèmes de sens portés par les individus (subjectivation) en vue d’une compréhension commune (inter-subjectivation). Si la littérature n’aborde pas directement les activités d’intermédiation lorsqu’elles sont prises en charge par les scientifiques eux-mêmes, les activités qui y sont associées à Parchemins constituent pourtant des pratiques d’ouverture de la science de plus en plus encouragées par les institutions de recherche, se transformant parfois en injonction.
Ce mémoire postule que ce les effets et ce qui est enrôlé dans l’injonction à ouvrir la science dont s’auto-astreint le collectif Parchemins afin de s’interroger sur leur façon de produire des connaissances collectives en vue d’accompagner un changement, ne peuvent être appréhendés que par l’observation de sa mise à l’épreuve en pratique. L’enquête ethnographique permet alors, dans une perspective pragmatique, de suivre les acteurs dans l’action et d’observer la manière dont les chercheurs et les chercheuses impliqués vont, chacun e à sa façon, percevoir cette injonction, la mettre en pratique et composer avec elle et quels sont les déplacements et apprentissages qui en résulte. Pour ce faire, le mémoire analyse la pratique de trois activités d’intermédiation expérimentées à Parchemins : la production radiophonique ; l’organisation d’espaces de rencontre et de délibération ; l’ouverture des données de la recherche. Le mémoire conclut sur le fait que ces activités ont pu engendrer une reconfiguration des conditions d’expression autour des questions d’agriculture littorale. Néanmoins, il a montré que même pour un collectif organisé pour y faire face, la confrontation de ces activités avec les normes et les cadres de l’activité scientifique a limité la capacité d’auto-organisation du collectif et que l’épreuve pratique qui en a résulté amène sans doute à reconsidérer les raisons et les formes pour lesquelles l’ouverture de la science est parfois transformée en injonction.
Mots clés: intermédiation, intersubjectivation, sujectivation, pragmatisme, épreuve, recherche collaborative, inter et transdisciplinarité, agriculture littorale, intention de transformation, transformation sociale, science ouverte.
- Pot M., 2018. Caractérisation de la diversité de l’agriculture d’un territoire littoral : la Presqu’île de Rhuys. Mémoire de Master 2 Fonctionnement et gestion des agrosystèmes. Agrocampus Ouest. Non publié, 27 p.
Résumé : Le projet Parchemins étudie les enjeux de l’agriculture littorale bretonne. Le terrain d’étude de la Presqu’île de Rhuys est caractérisé par un afflux de touristes et de résidents, et la proximité d’un pôle urbain. Ce contexte touristique et péri-urbain fait émerger des enjeux spécifiques pour l’agriculture, qui amènent à se demander en quoi l’agriculture sur la Presqu’île de Rhuys est spécifique, et comment elle est façonnée par le tourisme et l’urbanisation. Des éléments de réponse ont été apportés par la réalisation d’enquêtes agricoles qui ont mené à la caractérisation de la diversité des exploitations sur la Presqu’île, et par la comparaison avec des communes rétro-littorales. Les critères de caractérisation ont été choisis pour mettre à l’épreuve un cadre d’analyse développé par Therond et al. (2017), qui aborde le fonctionnement biotechnique et l’ancrage territorial des exploitations. A l’aide d’une analyse factorielle, ces critères ont permis de faire ressortir la diversité des exploitations. Le tourisme et l’urbanisation sont sources de contraintes mais représentent aussi une opportunité pour une diversification de l’activité (agritourisme, circuits courts). Les acteurs politiques et associatifs entraînent l’agriculture de la Presqu’île vers une écologisation et une relocalisation de la production, rendues favorables par le contexte. Les analyses pourront être complétées par des enquêtes sur des zones péri-urbaines non-littorales, et affinées par l’apport des sciences humaines et sociales.
Mots clés : fonctionnement biotechnique ; ancrage territorial ; enquêtes agricoles ; diversification ; écologisation.
- Cardinal J., 2018. L’insertion territoriale de l’agriculture : mise en perspective entre l’île de Bréhat et Ploubazlanec (Côtes d’Armor). Mémoire de Master 2 Environnement, dynamiques des territoires et sociétés. AgroParisTech. Non publié, 148 p.
Résumé : Ce mémoire porte sur l’insertion territoriale des agriculteurs, sur des espaces littoraux. A travers l’étude de cas de deux territoires situés dans les Côtes d’Armor, l’île de Bréhat et Ploubazlanec, il s’agit de questionner les évolutions que ces territoires qu’ils ont connu dans leur rapport au littoral, et la place accordée à l’agriculture dans que l’on appellera le « pacte territorial ». Autrefois marqués par des hybridations terre-mer qui caractérisaient fortement l’organisation des sociétés locales, les dynamiques de spécialisation de ces territoires s’accélèrent après la seconde guerre mondiale, et modifient les rapports au littoral. L’agriculture de Ploubazlanec s’est progressivement spécialisée dans la culture de légumes frais, et s’intègre dans la modernisation agricole caractéristique de l’après- guerre : tournée vers l’économie de marché, l’importance pédoclimatique du littoral est moins marquée. Le littoral, en tant que territoire convoité, attire de nombreux résidents secondaires et touristes, qui participent à la reformulation de la place que les agriculteurs prennent sur le territoire. Des conflits d’usage apparaissent. Sur Bréhat, le secteur du tourisme permet de faire vivre l’île. L’image de l’île aux fleurs adossée à l’île participe à la marginalisation des activités agricoles sur l’espace insulaire. Mais à l’aune de la nécessité de maintenir une population importante à l’année sur l’île, et par l’entrée des questions écologiques, de nouveaux projets agricoles émergent et fédèrent d’autres acteurs du territoire, renégociant les rapports de force.
Mots clés : territoires littoraux, agriculture, pacte territorial, agriculture insulaire, conflits d’usage
- Levain A., 2016. Une épreuve médiatique ? Les éleveurs bretons et les marées vertes. Etudes rurales, vol. 198, no. 2, pp. 171-194.
Résumé : Une période d’intense médiatisation a suivi la mise en évidence du danger sanitaire associé aux marées vertes en Bretagne en 2009. L’élevage intensif étant identifié comme la cause du phénomène, les éleveurs bretons ont été durant cette période très exposés médiatiquement. Fondé sur une enquête ethnographique, cet article montre comment les émotions qu’ils ressentent face à ces événements appellent une partie des éleveurs vers le repli, l’autre vers la mobilisation, sans que leurs représentants puissent d’emblée identifier les moyens d’une action coordonnée. Il décrit le processus de réappropriation de l’espace médiatique par les éleveurs, par des mobilisations mettant en scène leur détermination et les menaces pesant sur leur activité. De façon moins visible, de nouvelles stratégies de communication émergent et montrent comment le choc initial se transforme en expérience sociale.
Mots-clés : Bretagne, agriculture, élevage intensif, marées vertes, médiatisation, mobilisations sociales, pollution, sociologie des épreuves.
-
Gascuel C., Ruiz L., Vertès F. (coordinateurs) 2015. Comment réconcilier agriculture et littoral? Vers une agroécologie des territoires. Editions Quae, 152 p.
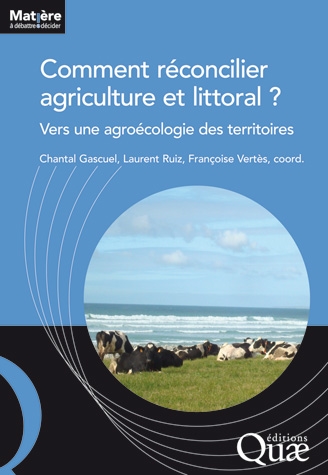
Description : Nous avons tous eu l’occasion d’observer des marées vertes dans certaines baies littorales… Ces perturbations écologiques liées à des excès de nutriments peuvent s’accompagner de conséquences négatives sur la santé et les activités humaines, que ce soit sur le bassin versant ou le littoral. Dans les bassins versants qui alimentent ces baies, les agrosystèmes doivent évoluer pour diminuer leurs émissions d’azote vers l’eau jusqu’à des niveaux parfois très bas. Le lien entre la dégradation des écosystèmes littoraux, les flux d’azote et l’agriculture a été établi mais cet ouvrage interroge de manière nouvelle leurs relations. Quelles connaissances a-t-on du fonctionnement des bassins versants et des systèmes agricoles ? Quelles transitions agroécologiques sont adaptées au territoire ? Comment les engager avec les acteurs concernés ?
Les modèles agroenvironnementaux sont-ils des outils privilégiés pour articuler connaissance et action, et contribuer à construire des projets de territoires ? Enfin, l’adoption de ces nouveaux systèmes résoudra-t-elle le problème des algues vertes ?
Pour y répondre, les auteurs s’appuient principalement sur les résultats du programme de recherche ACASSYA « ACcompagner l’évolution Agroécologique deS SYstèmes d’élevAge dans les bassins versants côtiers », financé par l’Agence nationale de la recherche. Ce programme est né d’une volonté des gestionnaires de territoires et des équipes de recherche de travailler ensemble.
Le territoire emblématique étudié est celui des bassins versants alimentant la baie de la Lieue de Grève dans les Côtes d’Armor. Toutefois, les résultats peuvent concerner tous les territoires du monde confrontés à des écosystèmes aquatiques littoraux dégradés. Ils s’appuient sur des connaissances génériques acquises dans les observatoires agrohydrologiques mis en place par la recherche.
Mots-clés : agriculture – algue – azote – bassin versant – développement durable – eau – écologie – élevage – environnement – hydrologie – insecte – mer – nitrate – pollution – prévention.
-
Levain A., Vertes F., Ruiz L., Delaby L., Gascuel-Odoux C., Barbier M., 2015. ‘I am an Intensive Guy’: The Possibility and Conditions of Reconciliation Through the Ecological Intensification Framework. Environmental Management. no. 56 (5), pp. 1184-1198.
Abstract : The need for better conciliation between food production and environmental protection calls for new conceptual approaches in agronomy. Ecological intensification (EI) is one of the most encouraging and successful conceptual frameworks for designing more sustainable agricultural systems, though relying upon semantic ambivalences and epistemic tensions. This article discusses abilities and limits of the EI framework in the context of strong social and environmental pressure for agricultural transition. The purpose is thus to put EI at stake in the light of the results of an interdisciplinary and participatory research project that explicitly adopted EI goals in livestock semi-industrialized farming systems. Is it possible to maintain livestock production systems that are simultaneously productive, sustainable, and viable and have low nitrate emissions in vulnerable coastal areas? If so, how do local stakeholders use these approaches? The main steps of the innovation process are described. The effects of political and social dynamics on the continuity of the transition process are analyzed, with a reflexive approach. This experiment invites one to consider that making EI operational in a context of socio-technical transition toward agroecology represents system innovation, requiring on-going dialogue, reflexivity, and long-term involvement by researchers.
Keywords : Intensive livestock farming, Land management, Nitrates, Grassland multi-functionality, Interdisciplinary research, Eutrophication, Green tides.